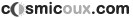Souvent évoqué, mais encore tabou, le harcèlement sexuel est une violence, une agression. Des psychiatres l’assimilent carrément à un crime, en révélant que le harcèlement, comme le viol, est une affaire de pouvoir, dans laquelle le harceleur, c’est-à-dire l’auteur de chantage, de souffrances, voire de traumatisme, agit à huis clos et évite donc de s’exposer au grand jour.
 En Algérie, ce phénomène existait déjà auparavant, mais il a pris de l’ampleur, en raison des profondes mutations qu’a connues le monde du travail. De nombreux observateurs affirment que les contrats à durée déterminée et le travail au noir, pour ne citer que ceux-là, facilitent le chantage et accélèrent la fragilisation de certaines catégories sociales, particulièrement les “maillons faibles” de la société. Dans un contexte de “disparition progressive des protections légales et réglementaires” avec l’informel et la généralisation du travail non déclaré, du recul des syndicats dans le secteur public et d’absence quasi totale de syndicats dans le privé, la rareté et la précarité de l’emploi constituent, selon eux, un terreau favorable au développement de ce fléau.
En Algérie, ce phénomène existait déjà auparavant, mais il a pris de l’ampleur, en raison des profondes mutations qu’a connues le monde du travail. De nombreux observateurs affirment que les contrats à durée déterminée et le travail au noir, pour ne citer que ceux-là, facilitent le chantage et accélèrent la fragilisation de certaines catégories sociales, particulièrement les “maillons faibles” de la société. Dans un contexte de “disparition progressive des protections légales et réglementaires” avec l’informel et la généralisation du travail non déclaré, du recul des syndicats dans le secteur public et d’absence quasi totale de syndicats dans le privé, la rareté et la précarité de l’emploi constituent, selon eux, un terreau favorable au développement de ce fléau.
Un terreau qui se nourrit des failles dans la législation, mais aussi des pesanteurs sociales et des contradictions portées par la société, en ciblant principalement les femmes travailleuses. Vu sous cet angle, le harcèlement sexuel se fonde bel et bien sur la discrimination des sexes et trouve matière dans l’inégalité entre les hommes et les femmes dans la société algérienne. Les violences contre les femmes sont, en effet, renforcées par le code de la famille. Un code qui, malgré les derniers amendements introduits, est en contradiction avec la Constitution, qui consacre pourtant l’égalité entre les hommes et les femmes.
Les violences faites aux femmes en général et le harcèlement sexuel en particulier sont reconnus et dénoncés par les plus grandes instances internationales, dont l’Organisations des Nations unies (ONU) et l’Organisation internationale du travail (OIT). Sur les lieux de travail, les syndicats et les organisations professionnelles sont sommés de s’impliquer directement dans la lutte contre ce fléau.
Cela, d’autant que le harcèlement sexuel en entreprise a des coûts économiques et sociaux. Si une femme, victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, de son supérieur ou de son collègue, se plaint, elle risque d’être licenciée pour faute professionnelle, de mettre une croix sur ses perspectives de promotion. Sinon, elle est contrainte de démissionner pour fuir l’humiliation ou de changer de service, lorsque cela est possible. Le harcèlement sexuel porte également atteinte au moral des travailleuses, qui sont réduites à des objets sexuels par leur harceleur, lequel leur dénie le droit de dire non à ses avances : ces victimes subissent un stress continu dans le lieu du travail, s’enferment dans l’absentéisme ou deviennent moins efficaces, car elles sont sans cesse sur le qui-vive.
Non-assistance à personne en danger
Le débat sur le harcèlement sexuel et sa condamnation officielle sont récents en Algérie. Ils viennent en appoint à la législation du travail ou des lois sociales de 1990 (loi 90-11 du 21 avril 1990 notamment) et adhèrent au contenu de l’article 34 de la Constitution, qui condamne “toute violence physique ou morale ou atteinte à la dignité” et rend, dans le même temps, l’État responsable de “l’inviolabilité de la personne humaine”. Dès 2002, les femmes syndicalistes, plus particulièrement les représentantes de la Commission nationale des femmes travailleuses (CNFT) de l’UGTA, créée à la suite du 10e congrès de la Centrale syndicale (octobre 2000) et présidée par la militante des droits des femmes, Soumia Salhi, ont été à l’origine de la campagne, la première du genre en Algérie, contre le harcèlement sexuel.
La CNFT s’est investie sur le terrain, soutenant et prenant en charge les victimes, par le biais du centre d’écoute et d’aide. Grâce aux témoignages de ces femmes travailleuses, une seconde campagne de plaidoyer a été engagée, en 2003. En mars de cette année, la CNFT a proposé l’incrimination du harcèlement sexuel et déposé une demande d’amendements du code pénal. Résultat des courses : l’article 341 bis est né, qui stipule que “toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle” est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel.
Désormais, la loi punit le harceleur d’un emprisonnement de 2 mois à un an et d’une amende de 50 000 DA à 100 000 DA. En cas de récidive, la peine est portée au double. Par son existence même, l’article 341 bis a ainsi brisé le silence. Par ailleurs, il condamne le harceleur et réhabilite la victime.
Mais, quatre ans plus tard, en mars 2008, le ministre de la Justice est de nouveau interpellé par lettre ouverte sur les limites de cet article. Une troisième campagne est également lancée, par la CNFT et d’autres organisations et associations, dont le réseau Wassila, le Ciddef, Rachda, Djazaïrouna, SOS Femmes en détresse et l’association Planification familiale (APF), à la fin de 2008, qui se poursuit toujours. Pour toutes ces associations, ne pas dénoncer le harceleur est “une non-assistance à personne en danger”. D’où l’importance de cette campagne nationale qui demande essentiellement l’amendement de l’article 341 bis du code pénal, pour garantir la protection des victimes et des témoins contre toutes représailles. Aujourd’hui, l’article 341 bis a montré ses insuffisances. Les règles générales pour l’établissement de la preuve sont en effet loin de répondre à l’objectif recherché, à savoir l’incrimination réelle du harcèlement sexuel. D’où la nécessité d’asseoir des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, et la protection des témoins contre les représailles administratives. Donc, la balle est dans le camp des dirigeants, plus particulièrement du responsable du département de la Justice, Tayeb Belaïz.
Enquête sur le Harcèlement sexuel en milieu professionnel en Algérie
Depuis quelques années, l’Algérie figure parmi les pays qui s’attaquent au harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Seulement, l’article 341bis du code pénal, tel qu’énoncé, a montré ses limites. Aujourd’hui, le moment est venu de le compléter, à la lumière des difficultés rencontrées, dans la pratique, par les victimes.
919 lectures
URL de rétrolien : http://www.algerlablanche.com/index.php?trackback/575